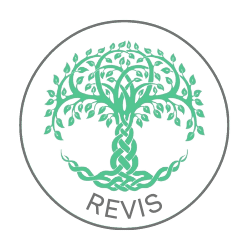PARLER DE SON TAUMATISME

Temps de lecture 12 minutes.
QUAND ET COMMENT PARLER DE SON TRAUMATISME À SON PARTENAIRE ?
Depuis de nombreuses années, je porte en moi les éclats du traumatisme : dans mes joues, dans mes poches, sur mon dos. Certains de ces éclats sont durs et font encore couler le sang ; d’autres ont été lissés par le temps, se baladent à l’intérieur de moi et s’érodent. Des éclats, des cailloux, des galets, des rochers et quelques géodes bien laids à l’extérieur mais d’une beauté envoûtante à l’intérieur.
Il y a dix ans, alors que nous marchions main dans la main, comme le font les jeunes amoureux, mes mains étaient moites avec la chaleur et la nervosité. J’étais à Portland pour le weekend avec un homme avec qui je sortais depuis quatre mois, ma plus longue relation. En fait, c’était la seule. J’avais 28 ans et je sortais beaucoup, mais je n’avais jamais eu de petit ami. Je n’étais pas encore tombée amoureuse et n’avais pas encore fait l’amour.
Je n’avais pas l’impression de rater quoi que ce soit, mais je m’inquiétais de ce que cela révélait sur moi. Je ne me sentais attirée ni physiquement ni romantiquement par quiconque, mais j’avais envie de l’être. J’évitais les lits et les recoins des clubs de danse. Je riais quand les gens plaisantaient sur le sexe. Je ne pouvais pas comprendre les comédies romantiques ou les drames relationnels de mes amis. Je me demandais si j’étais brisée. Des années d’abus durant mon enfance, de la part de mon père, ont brûlé à travers ma peau jusqu’à mon esprit. Je disais à mes amis, et en moi-même, que je savais ce que je recherchais. Je voulais – non, j’avais besoin – d’un partenaire en qui je pouvais avoir confiance. Je devais me sentir à l’aise. Mes amis me disaient que j’étais trop difficile, qu’il n’y avait pas de M. Parfait, que je devrais aller en thérapie. Je riais de ces remarques, mais leurs paroles me trottaient toujours dans la tête. Avaient-ils raison ? Je savais que je voulais fonder une famille un jour, mais je ne savais pas comment y arriver ni même si je le pouvais.
Ceux d’entre nous qui survivent aux traumatismes sont les Sisyphe d’aujourd’hui ; nous poussons nos rochers traumatiques jour après jour vers le sommet. Parfois, par de belles journées d’été, nous transpirons et nous tremblons, mais nous pouvons tout de même sentir le soleil scintiller sur notre dos. D’autres fois, il fait un temps affreux, pluvieux et glacial. Nous tremblons en nous demandant pourquoi personne ne sort pour nous aider. Au cours de notre weekend, deux skateurs sont passés près de nous, nous écrasant presque. Mon petit ami m’a tirée hors de leur chemin juste à temps. Nous sommes montés et descendus du tramway de Portland et du Max, émerveillés par les transports en commun. Nous avons étudié les menus dans les vitrines, envisageant de renoncer au dîner pour de la glace et nous avons finalement opté pour les deux – la glace d’abord. J’étais heureuse. J’étais terrifiée.
Le traumatisme de mon enfance qui m’a dépouillée de maintes façons n’a laissé que l’ombre d’une femme. J’avais récemment déménagé de New York à Seattle, dans l’espoir de recommencer une nouvelle vie. J’avais peur du sexe, de l’intimité, des hommes. Ce que je craignais le plus, c’était de devenir mère. Mais, oh combien je voulais être mère. En étant si blessée, je m’inquiétais de savoir si je pourrais fonder une famille saine. Rencontrer ce petit ami (qui est devenu par la suite mon mari), c’était du gâteau. On s’est rencontré à la fête d’Halloween chez un ami commun. Il était déguisé en autruche, ce que je trouvais amusant. J’étais, cependant, plus intéressée par le costume que par l’homme qui le portait. À ce stade de ma vie, mon regard ne se portait par sur des partenaires potentiels. Je m’étais plus ou moins résignée à être célibataire. En bavardant, nous avons découvert que nous avions tous les deux fréquenté le même lycée du Midwest. Au fil des mois, grâce aux réseaux sociaux et à l’aide d’amis, cet homme-autruche et moi sommes devenus amis. Quelques mois plus tard, il m’a finalement invitée à sortir.
Nous avons parcouru les rayons de la librairie Powell’s Bookstore : les biographies, la romance, le développement personnel, les livres pour enfants. Les aimants littéraires nous ont fait rire et nous avons acheté des bouteilles d’eau commémoratives. Dois-je lui dire maintenant ? J’ai réfléchi et j’ai décidé que non, pas ici. Plus tard, en mangeant au restaurant, je me suis demandée : dois-je révéler mon plus grand secret maintenant ? Il y avait tellement de gens à portée de voix. Le serveur nous tournait autour. Combien de temps faudrait-il ? Est-ce que ça allait être comme les aveux que j’ai vus dans les films ? Est-ce que j’allais pleurer ? J’ai décidé de ne pas le faire et j’ai continué à manger mes frites.
Plus tard dans la nuit, alors que nous nous embrassions, je me suis demandé : Est-ce que ça serait bizarre maintenant ? Oui. Nous étions dans un hôtel branché du centre-ville de Portland. Pendant que nous nous embrassions, je ne pouvais pas empêcher mes pensées de s’enfoncer dans les profondeurs. Des relents de mains lourdes et d’haleine alcoolique de mon père m’ont traversé l’esprit. C’était peut-être le bon moment. C’était peut-être pas le bon moment.
Je me suis éloignée et j’ai pris une grande inspiration, en remettant mes vêtements en place. Mon cœur battait deux fois plus vite, un pour le moi adulte et un autre pour le moi enfant. Mon petit ami semblait surpris de ce brusque revirement, mais il s’est gentiment éloigné et assis. C’était le moment, je me suis dit. Sans le regarder dans les yeux et en lui tournant le dos, j’ai dit, hésitante : Donc j’ai quelque chose à te dire. Mon père, eh bien, tu sais, il, eh bien, je veux dire, il était plutôt horrible… et il a fait des choses.
Mon petit ami m’a tiré contre lui en enroulant ses longs bras autour de moi. Mon dos contre son torse, on ne s’est pas regardés. Je ne me souviens pas de ses paroles exactes. Mais c’est à ce moment que j’ai su qu’il était le partenaire digne de confiance que j’attendais. En me serrant dans ses bras, il a pris un caillou, un de mes petit morceaux de rocher. Et je me suis sentie plus légère. J’ai donc poursuivi mon histoire en laissant de côté certaines parties, sans entrer dans les détails. Il y a des roches qui sont plus difficiles à lâcher. Mais j’ai dit très clairement qu’étant enfant, j’ai été maltraitée de toutes sortes de manières : émotionnellement, physiquement, sexuellement. J’ai été négligée d’une façon qu’on n’aurait peut-être jamais soupçonnée de l’extérieur. Je lui ai dit que j’avais peur. La honte est quelque chose que nous portons, que nous le voulions ou non. Et c’est trop lourd pour une personne seule à supporter – nous ne sommes pas conçus pour porter cela tous les jours, toute la journée. Parfois, il faut poser ce rocher. Maintenant, mon mari m’aide à le porter. Parfois il en prend plus, parfois moins, et chaque jour nous recommençons.
Comme mon partenaire connaît mon passé, cela facilite certaines conversations. Si un homme regarde trop longtemps ma fille et je devient méfiante, mon mari le comprend. Quand je me soucie d’échouer en tant que mère, mon mari le comprend. Quand j’ai besoin que notre maison soit propre, mon mari comprend que cela va au-delà de la râlerie. Il sait que cette saleté me renvoie à la maison de mon enfance. Quand #Metoo a commencé à être connu, il a compris ce que cela signifiait pour moi.
J’ai eu des amis avec des degrés et types de traumatismes plus ou moins graves qui m’ont demandé : Est-ce que je devrais partager cela avec mon conjoint ? Que va-il penser de moi ? La honte est excessivement lourde et peut facilement nous enterrer. Chaque relation est différente, bien sûr, mais il est tellement plus facile d’avoir quelqu’un pour aider à porter les pierres.
Au cours des premiers jours, la grande question surgit : Dois-je lui parler de mon traumatisme de l’enfance ? Je voulais qu’il comprenne que mon extrême nervosité face au sexe et à l’amour avait ses racines. Que les mauvais traitements infligés par mon père ont laissé une marque indélébile sur ma peau et sur mon esprit. Si cette personne était celle avec qui je finirai ma vie, ne devait-elle pas connaître les situations que j’ai endurées avant de devenir la personne que je suis maintenant, avec le bon comme le mauvais ?
À l’ère du #Metoo, il peut sembler plus facile de se dévoiler en tant que victime d’agression sexuelle, de harcèlement ou de relation abusive.
Mais ce n’est pas parce que les gens se manifestent en grand nombre qu’il est facile de le faire. Et que se passe-t-il quand vous n’êtes pas sur les médias sociaux – quand vous êtes dans la vraie vie et dans une relation nouvelle ?
« C’est vraiment difficile d’avoir la plupart de ces conversations dans des forums publics », dit Amanda Lindamood, directrice de la formation et de l’engagement communautaire du DC Rape Crisis Center, ajoutant que quelqu’un pourrait voir le poste d’une victime et se demander ce que cela signifie pour sa relation avec cette personne.
A quel moment vous ouvrir à quelqu’un avec qui vous pourriez avoir une vie future, à propos de choses douloureuses de votre passé ? Qu’est-ce qui est important pour eux de savoir, et qu’est-ce qui ne l’est pas ? Et à quoi ressemblerait une réponse compréhensive ?
Nous avons parlé à une victime de viol et de relation violente, ainsi qu’à deux professionnels qui travaillent avec des victimes de viol, afin de faire ressortir certains éléments à prendre en compte avant de discuter de ce sujet. Mais tout d’abord, deux mises en garde : Ce n’est pas parce que beaucoup de gens le font que vous devez le faire. Les suggestions ne sont pas nécessairement universelles.
Ne divulguez que si et quand vous vous sentez prêt.
Jess Davidson, directrice par intérim de End Rape on Campus, souligne que puisque l’agression sexuelle prive les victimes de leur pouvoir décisionnel, il est important qu’elles puissent décider de quand et comment elles souhaitent parler des expériences qu’elles ont vécues.
« Les survivants ne devraient jamais se sentir coupables de se centrer sur leurs propres besoins, qu’il s’agisse de partager avec leur partenaire ou de ne pas le faire « , dit Davidson. De même, Lindamood du DC Rape Crisis Center dit qu’elle préconise la délibération. « Comment se fait-il que ce ne soit pas une obligation, ou une impulsion ? » dit-elle. » Dans l’idéal, ce ne doit pas être un choix que vous n’avez pas eu l’occasion de faire par vous-même. C’est quelque chose dont vous devez vous sentir en contrôle, et pour lequel vous devez vous sentir bien préparé.
« Pensez à l’endroit où vous voulez avoir cette conversation. Une survivante de viol et de violence conjugale âgée de 33 ans a raconté qu’avant elle avait l’habitude de parler à ses nouveaux partenaires de son traumatisme passé sur l’oreiller, mais comme cela peut se révéler un moment tellement intime et vulnérable, elle préfère maintenant aborder ce sujet pendant un repas ou dans un lieu autre que la chambre.
Elle n’a pas d’échéancier strict, dit-elle, mais elle en parle habituellement avant qu’une nouvelle relation ne passe d’occasionnelle à sérieuse. Avoir cette conversation avec un nouveau partenaire une fois qu’elle sait qu’elle peut lui faire confiance » n’a fait qu’augmenter notre niveau d’intimité « , dit-elle.
N’hésitez pas à établir des règles de base sur la façon dont vous aimeriez que l’autre réponde. Lindamood suggère d’ouvrir la conversation en établissant des lignes directrices sur la façon dont votre partenaire pourrait répondre et de créer un espace pour que vous puissiez parler ouvertement. « Donner des indications sur ce qui vous parait être une réponse de soutien », dit Lindamood. Par exemple : J’ai besoin que tu ne m’interrompes pas avant que j’aie fini. Je ne suis pas prêt à répondre à des questions. Ou : J’ai besoin que tu prennes un peu de temps avant qu’on en reparle. » Le dévoilement des faits a un impact sur la personne qui les entend et sur la personne qui les divulgue « , ajoute M. Lindamood.
Les réponses que vous obtiendrez peuvent varier considérablement. »Quand j’avais la vingtaine, à chaque fois que je le révélais à un homme, il répondait en disant : ‘’J’aimerais pouvoir lui faire du mal ». Ou : « Tu veux que je le cogne ? » dit notre survivante de 33 ans. Dans sa trentaine, les réponses ont davantage porté sur elle que sur l’agresseur : » Que puis-je faire pour que tu te sentes en sécurité et à l’aise ? » Ce à quoi elle répond généralement : « Sois qui tu es. Si tu es un bon gars, sois juste un bon gars. »Établissez des moyens de communiquer vos besoins pendant les rapports sexuels et autres activités qui pourraient être des déclencheurs.
Les traumatismes ne se règlent pas de façon linéaire, note Davidson. « L’idée que les survivants ne puissent pas ou ne veulent pas avoir une vie sexuelle saine après une agression est fausse », dit Davidson. Elle suggère de pratiquer le consentement affirmatif pendant les rapports sexuels, ce qui signifie que les deux partenaires doivent s’entendre mutuellement sur l’activité sexuelle, ce qui peut aider à éviter de se retrouver dans une situation où un survivant se sent impuissant. « Le consentement affirmatif permet aux survivants de communiquer ce qu’ils veulent et comment ils le veulent – et ne repose pas sur l’hypothèse que parce qu’ils ont été agressés, ils ne veulent pas avoir de rapports physiques » ajoute Davidson. Elle suggère également d’avoir un mot d’alerte à utiliser pour interrompre l’activité sexuelle si l’on se sent »déclenché » ou si l’on a des flashbacks.
Sources
The Washington Post – When do I tell my partner about my past trauma? / How to tell a new partner about your past sexual trauma